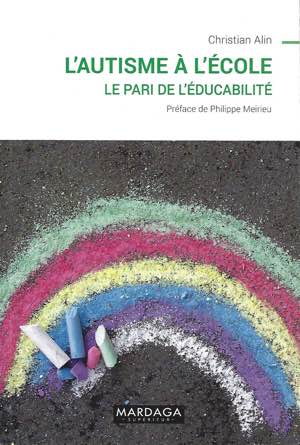|
Pour une inclusion porteuse d’humanité contagieuse
Une École, comme toute « institution authentique », est inclusive ou elle n’est pas. Cela ne signifie évidemment pas que l’inclusion y est déjà entièrement réalisée et que l’on a éradiqué toute trace d’exclusion, voire de marginalisation. Cela signifie qu’il n’y a d’« institution » – ce qui institue l’humanité et fait tenir les humains ensemble – que si le processus d’inclusion y est à l’œuvre. Car « inclure », c’est bien « faire humanité ensemble », relier entre eux des êtres pour agrandir le cercle, augmenter le partage, fabriquer de l’unité et donner du sens à notre aventure commune. « Inclure », c’est chercher obstinément ce qui peut nous rassembler et nous permettre de nous enrichir réciproquement. « Inclure », c’est créer du commun. Notre École a payé et continue de payer un lourd tribut à l’identité. Depuis que Guizot – qui n’était ni républicain, ni démocrate… faut-il le rappeler ? – a imposé à notre système scolaire le « modèle simultané » contre le « modèle mutuel », nous vivons avec le mythe de la classe homogène. La « forme scolaire » qu’il a ainsi installée renvoie, en effet, à une architecture essentiellement « disciplinaire » (aux deux sens du terme) qui réunit un groupe d’enfants du même âge et du même niveau assignés à faire tous la même chose en même temps. Et cet « idéal » est si prégnant, si vivant encore dans les esprits, malgré son incapacité notoire à garantir la démocratisation des savoirs et la formation aux valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, que nous peinons encore à lui imaginer des alternatives. Il continue donc à « fonctionner », toujours de manière aussi puissante et avec les mêmes effets dévastateurs : l’externalisation systématique de ceux et celles qui pourraient, d’une manière ou d’une autre, briser « l’unité » à laquelle il réfère sa « réussite ». L’homogénéité qu’il veut instituer – ou celle que l’imaginaire collectif croit nécessaire à toute forme de scolarisation – engendre, en effet, un fonctionnement centrifuge qui renvoie à l’extérieur, et toujours de plus en plus loin, toute forme de difficulté et, a fortiori, d’anomie. Pour que la classe reste homogène, il faut en sortir tout ce qui ne correspond pas à la norme, tout ce qui résiste, peu ou prou, à un fonctionnement imposé, tout ce qui témoigne d’un autre rapport à soi, aux savoirs et au monde. Et, malgré nos dénégations officielles, le mouvement ne se réduit pas aujourd’hui mais s’amplifie : dispositifs multiples d’aide et de soutien, accompagnements gratuits ou payants, en présentiel ou à distance, rééducations et thérapies de toutes sortes… tout se passe comme si l’essentiel ne se jouait plus dans la classe mais ailleurs. Pour le plus grand malheur des maîtres et des élèves : dans une centrifugeuse, en effet, l’expulsion de ce que la machine ne peut digérer s’accompagne toujours du creusement d’une dépression au centre. L’homogène prolifère comme le cancer. Les échanges s’appauvrissent. Plus rien ne vient stimuler l’inventivité du maître. L’altérité disparue, chacun s’étiole, se replie sur lui-même et, finalement, s’ennuie. Il apparaît de plus en plus clairement que « la vraie vie est ailleurs ». Car le tri se fait toujours, en effet, au détriment de la vie et de la santé de l’institution. C’est pourquoi le livre de Christian Alin est si important. Important en ce qu’il fait de l’inclusion un enjeu sociétal et humain et non simplement un moyen de satisfaire une demande des familles. Important en ce qu’il fait du processus de l’inclusion de ces enfants à l’étrangeté radicale que sont les autistes une dimension fondatrice de l’humanisation de notre École. Important en ce qu’il montre à quel point le projet d’inclure ces enfants « extra-ordinaires » est un projet éthique et politique. Important en ce qu’il fait le pari du pédagogique, non pour nier l’importance du thérapeutique – nécessaire pur soulager les souffrances – mais parce que l’entrée par les apprentissages et le souci de la transmission sont, tout à la fois, un signe de reconnaissance d’humanité et un moyen infiniment précieux pour permettre à chacune et à chacun, quel que soit son « handicap », de progresser en entrant en relation avec les autres et le monde. Ainsi, ceux qui imaginent que l’inclusion n’est qu’affaire de « bons sentiments » ignorent à quel point ils peuvent, à leur insu, préparer de tragiques retours en arrière. L’inclusion sans engagement ni travail, sans volonté politique ni partenariat pédagogique, ne prépare jamais que de l’exclusion à terme, sous l’œil plus ou moins satisfait des spécialistes du « je vous l’avais bien dit » ! Aussi trouvera-t-on, dans ce livre, un ensemble de données d’une qualité exceptionnelle et un propos d’une rare vigueur intellectuelle. On le lira « comme un roman » et on l’utilisera, au quotidien, comme une « boîte à outils ». Car il ne délivre pas seulement de l’information, il permet d’entrer dans une démarche. Une démarche d’inclusion, une démarche contagieuse d’humanité, une démarche sérieuse mais aussi pleine de ces satisfactions minuscules qui font le bonheur de l’éducateur. Quand, dans « le moindre geste » – et je suis heureux d’évoquer ici Fernand Deligny – s’avère porteur un bonheur infini… Ce livre, croyez-moi, est un « livre de bonheurs ». De bonheurs de lecture. De bonheurs de vie. De bonheurs d’avenir. Philippe Meirieu
|