|
On préfèrerait parfois que nos adversaires aient raison. Ainsi, par exemple, dans ces philippiques où ils stigmatisent l’abandon du cours magistral au profit d’ « activités » de toutes sortes où les élèves discuteraient joyeusement pendant que le maître serait réduit à une « personne-ressource » soutenant le travail des uns, expliquant les consignes aux autres, précisant, quand c’est nécessaire, les données d’un problème ou renvoyant à des documents complémentaires… On aimerait bien qu’une telle manière de travailler soit aussi répandue qu’on cherche à nous le faire croire. On le souhaiterait ardemment, et pas seulement en classes maternelles et élémentaires ! On voudrait bien que les élèves de collèges et de lycées, par exemple, soient amenés plus souvent à travailler vraiment en classe en se coltinant ensemble un problème difficile. On préfèrerait qu’ils tâtonnent ainsi un peu plus, avançant de manière solidaire et exigeante, plutôt que de s’en remettre à un cours écouté distraitement et à une assimilation hypothétique lors du « travail à la maison ». Car, dans la classe dont il sera question dans ce livre, les élèves ne sont pas assis sagement les uns à côté des autres, bouche bée devant la parole du maître qui incarne la Raison dans l’Histoire… Ils discutent entre eux, confrontent des points de vue, imaginent des objections, envisagent des hypothèses et cherchent à les réfuter, s’interrogent sur l’avancée de leur tâche commune et de leurs progressions réciproques. Dans le discours pédagogique injustement ridiculisé, on dira qu’ils tentent de « construire eux-mêmes leur propre savoir »… Nul, pourtant - ni eux, ni leur maître - n’imagine qu’ils vont redécouvrir spontanément la relativité générale d’Einstein ou rédiger un poème digne de Musset, Lautréamont ou Breton ! Chacun sait bien que le travail de groupe est aux antipodes de la caricature qu’on en fait, qu’il est loin de la non-directivité absolue, qu’il suppose une préparation minutieuse et un ensemble d’apports très structurés. Tout le monde a compris que cette méthode est un moment particulier inscrit dans l’ensemble d’une séquence d’apprentissage et qu’elle s’articule avec des moments de présentation collective, de travail individuel, de recherche expérimentale, d’évaluation, de métacognition, etc. Tous les enseignants, ou presque, ont appris à distinguer la tâche d’un groupe – dont l’évaluation sociale est secondaire - de l’objectif d’acquisition individuel qui doit, lui, être évalué prioritairement. Tout le monde sait cela depuis bien longtemps… mais les pratiques résistent et, contre toute évidence, restent calquées sur le modèle de l’auditorium scriptorium. C’est que nous sommes tributaires de représentations approximatives de la transmission. Et que, surtout, nous utilisons massivement des illusions rétrospectives : les illusions de ceux qui sont déjà « du côté du savoir » et qui, oublieux de leur propre histoire intellectuelle ou fixés sur des formes historiquement ou sociologiquement datées de celle-ci, ne « comprennent pas qu’on ne comprenne pas »… Bien sûr qu’on peut apprendre en écoutant simplement celui qui sait ! C’est, d’ailleurs, la formule la plus économique en temps et en énergie ! Mais elle suppose, pour fonctionner, une appétence, un questionnement intérieur préalable qui crée une mobilisation sur les savoirs, une attention capable de se fixer sur des objets mentaux, un « débat intérieur » qui permet à ce qui vient du dehors d’interagir avec ce qui était déjà au-dedans et de construire de nouvelles configurations intellectuelles… Bien sûr, tout cela est possible ; c’est même pratiqué quotidiennement par les « bons élèves » et par nous-mêmes, chaque fois que nous décidons de nous mettre en activité intellectuelle, comme par la lecture de ce livre, par exemple… Mais l’aspiration, que chacun prétend partager aujourd’hui, à la démocratisation de la réussite à l’école suppose qu’on ne se contente pas de laisser fonctionner « librement » ceux et celles qui ont eu la chance d’apprendre ailleurs que savoir, c’est comprendre et que comprendre suppose de verbaliser, d’interroger, d’opérer, d’échanger, de dialectiser, de formaliser, de mettre à l’épreuve, etc. La démocratisation de la réussite dans l’école - et pas seulement de l’accès à l’école - suppose un surcroît d’artefacts pour que chacune et chacun aient la possibilité de d’accéder à l’intelligence de l’intelligence. Même si l’enseignant ne peut jamais – heureusement – espérer agir « à coup sûr », il lui revient de traquer l’aléatoire et de construire des dispositifs qui permettent à l’élève de se mettre en mouvement mentalement et « d’opérer dans sa tête ». C’est ainsi qu’il faut comprendre l’apostrophe de Piaget : « Enseigner, ce n’est pas transmettre des connaissances, c’est donner des consignes de travail. » Évidemment, Piaget n’est pas naïf : en tant qu’universitaire, conférencier et auteur de livres et d’articles, il passe son temps à « transmettre des connaissances » et ne sous-estime nullement l’importance de cette opération. Mais il explique que ses auditeurs ou ses lecteurs sont supposés, dans ces cas-là, mettre en œuvre les activités mentales qui permettent l’appropriation des connaissances en question… Un élève – celui qu’on élève – n’est pas supposé, lui, disposer spontanément des capacités mentales opérationnelles. D’où l’impératif, affreusement trivial et absolument essentiel : « Donner des consignes pour mettre les élèves au travail. » Faire en sorte qu’en agissant, selon des consignes précises, sur des matériaux correctement choisis, les élèves soient amenés à s’exhausser au-dessus de ce qu’ils savent et à construire de nouveaux schèmes et de nouveaux savoirs. On ne mesure pas la révolution pédagogique – « copernicienne », comme disait Claparède – dont il s’agit là ! Révolution, en amont, dans la conception et la préparation des cours : on ne se demande plus seulement ce qu’on va dire aux élèves… mais ce qu’on va leur faire faire pour qu’ils accèdent à des connaissances données. Révolution dans la structuration de la classe : au lieu de cet ensemble d’individus indifférenciés censés être captés par la magie du verbe dès leur entrée dans la salle… on organise l’espace et le temps, avec des consignes précises, fermes et auxquelles on ne déroge pas. Révolution dans la gestion du cours : plus question de multiplier les rappels à l’ordre inefficaces, les exhortations au calme, les interventions qui, sous prétexte de neutraliser un gêneur, créent une excitation inutile… on met en place des dispositifs et des règles du jeu claires qui structurent aussi bien le travail que le groupe. Révolution dans les relations entre pairs : plus question de considérer toute communication entre eux comme un complot contre le maître… la solidarité devient un atout pour la réussite de chacun. Révolution dans la conception d’une école bien essoufflée : en lieu et place de cette juxtaposition de segments encyclopédiques déconnectés les uns des autres et sans véritable signification… des activités où l’on peut et doit s’investir ensemble sur des enjeux perceptibles par tous. Bref, on voit qu’il est temps – enfin ! – d’ « oser le travail de groupe ». L’école est malade de ces cours sans fin, sans méthode ni structure, où, dans les pires des cas, il ne s’agit plus que de « tenir », c’est-à-dire de « les tenir ». L’école est malade de cette indifférenciation des temps d’où rien n’émerge et où aucune véritable activité intellectuelle n’est stimulée… On verra, dans ce livre que des élèves dont tout le monde ou presque avait désespéré, peuvent, grâce au travail de groupe, retrouver une place dans un collectif et le goût d’apprendre dans la classe. On verra que rien, là, n’est du temps perdu. Bien au contraire ! Mais, pour oser le travail de groupe sans risque de débordement, sans la menace du retour rapide à la « magistralité exclusive », sous l’œil satisfait et sadique des spécialistes du « je vous l’avais bien dit ! », il faut un peu de formation, quelques clés et la capacité de gérer au mieux les difficultés qui ne manquent pas de surgir… Il faut donc « oser le travail de groupe » rigoureusement. En sachant ce qu’on cherche et en identifiant les moyens précis pour y parvenir. En précisant, chaque fois, les objectifs et les méthodes : un binôme d’élèves qui verbalisent réciproquement une définition qu’on vient de donner n’a pas le même sens qu’un groupe de projet qui doit mener sur le long terme une activité de création artistique. Un travail collectif sur un petit exercice ne s’introduit pas et ne se gère pas comme un groupe qui travaille toute l’année ensemble pour s’entraider. Un groupe d’apprentissage qui doit permettre la construction d’une notion précise ne fonctionne pas comme un groupe d’investigation qui doit explorer des hypothèses qui seront ensuite soumises à la classe… On trouvera des éléments sur tout cela – et sur bien d’autres choses encore – dans ce livre. On aurait tort, cependant de le réduire à un livre de recettes. C’est, à proprement parler, un livre de pédagogie : il nous dit où et comment emmener nos élèves. Pour qu’ils s’instruisent et s’émancipent à la fois. Pour qu’ils soient, en même temps, plus cultivés et plus solidaires. Qui oserait dire que ce n’est pas important ? Philippe Meirieu Professeur à l’université LUMIERE-Lyon 2
|
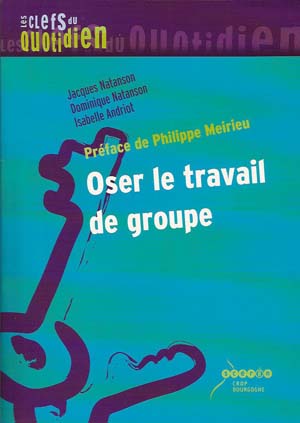 Mettre les élèves au travail
Mettre les élèves au travail