Philippe Meirieu
|
|---|
|
Un livre particulièrement intéressant Je fais partie de ceux qui ont aimé le livre de François Bégaudeau Entre les murs. L’ouvrage comporte, en effet, un travail particulièrement intéressant sur le langage : on y ressent une belle jouissance de lecture due, de toute évidence, à l’usage d’une langue métissée qui jaillit, à chaque ligne, avec une fantastique liberté. Le roman a un vrai pouvoir évocateur, le pouvoir de « créer un monde » et de nous y projeter. On y trouve aussi un humour « sur la lame du rasoir » : le lecteur est ainsi placé dans une ambivalence qui suscite, en permanence, chez lui l’étonnement. Cet étonnement constant est un des grands mérites du livre : il permet la réflexion et la mise à distance. Le héros-narrateur autorise ainsi une multitude de postures à son égard : de l’attendrissement à la colère, de l’inquiétude à la révolte. Ce livre se donne donc, d’abord, comme un « texte » – c’est-à-dire un discours dont la matière première est le langage – avec lequel on peut dialoguer et se mettre en jeu… En un mot, c’est de la littérature. Bien sûr, on peut aussi interroger cet ouvrage avec un regard pédagogique. La chose est, d’ailleurs, d’autant plus aisée que le narrateur laisse entendre sa grande difficulté à mettre en cohérence ses idéaux et ses actes. Ainsi, après avoir dit à deux élèves qu’elles avaient une « attitude de pétasses », le voit-on « pivoter sur place pour s’engouffrer dans l’escalier ». « Tout de suite, ajoute-t-il, mes yeux ont piqué. » La qualité littéraire est ici, au service, d’une interrogation pédagogique sur la bonne distance aux élèves, le niveau de langage qui permet de se faire entendre d’eux, la manière de rattraper d’inévitables dérapages... Toutes questions que tout enseignant – et pas seulement un débutant – se pose.
J’avais, moi-même accueilli François Bégaudeau, à la sortie de son roman, à L’Institut Universitaire de Formation des Maîtres de l’Académie de Lyon. Nous avions enregistré alors une émission de radio (qu’on peut réécouter aujourd’hui, dans une version volontairement non montée : http://www.meirieu.com/RADIO/francoisbegaudeau.mp3 ). Dans le style très spécifique imposé par ce genre particulier, nous avions eu une discussion stimulante. L’auteur nous avait d’abord lu un extrait de son livre : tout le monde avait eu plaisir à l’entendre tant l’originalité littéraire du texte était forte ; il y avait là un ton particulier qui, à l’évidence, « faisait littérature »… Ce qui ne nous a pas empêché de débattre, ensuite, de la question des comportements pédagogiques de son « héros » et de nous trouver en désaccord sur la manière qu’a le narrateur de « faire la classe ». J’avais, à l’époque, dit mon malaise face à certains passages du livre, souligné le caractère illusoire et dangereux de l’égalité instaurée entre le professeur et ses élèves, montré qu’il n’était pas très sain de concevoir la classe comme « un champ de bataille », expliqué l’importance de ne pas s’installer dans le malentendu permanent avec des adolescents, insisté sur le caractère fondamental des acquisitions scolaires et la nécessité du travail sur les contenus, évoqué le danger du relativisme culturel et exprimé mon inquiétude devant la surchauffe affective provoquée par le « héros »… François Bégaudeau avait répondu, de manière nuancée, insistant sur la nécessité de faire le lien entre les préoccupations « spontanées » des élèves et les « grandes œuvres », se présentant comme un professeur animé du désir de transmettre et conscient de ses faiblesses pédagogiques. En réponse à un professeur stagiaire, il avait même précisé qu’il faut éviter tout amalgame entre « la culture jeune » et « le champ culturel de l’école », avant de conclure que le livre était un « objet littéraire » et devait, d’abord, être traité en tant que tel. Au moment de la Palme d’Or, je m’étais réjoui, sans avoir vu le film, qu’une œuvre qui parle de l’école soit ainsi couronnée, ajoutant, dans le journal Libération, que c’était une excellente chose de « replacer l’éducation au cœur des enjeux de société, de montrer la réalité du terrain scolaire » et que cela pourrait permettre, sans doute, « de sortir des traditionnels débats idéologiques sur l’école ».C’était compter sans la spécificité du traitement cinématographique et le danger permanent de réduire la vibration d’une écriture à un ensemble de clichés… C’était compter sans les aléas d’une adaptation contrainte de « dramatiser » ce qui était présenté, dans le livre, comme une « chronique »… C’était compter sans l’instrumentalisation inévitable d’un film dont le statut, aujourd’hui, est plus celui d’un « objet social » que d’une « œuvre d’art ». Le film : une œuvre d’art d’abord Du côté de l’œuvre d’art, il faut, bien sûr, s’incliner devant la performance : un huis clos, ou presque, magistralement filmé, avec une grande force dans les images, épurées à l’extrême, sans effets inutiles. Il faut insister aussi sur la performance des adolescents qui jouent avec un « naturel » extraordinaire : on nous dit que des ateliers de travail d’acteur ont été mis en place pour eux. Ces derniers ont, de toute évidence, été très formateurs et, d’ailleurs, il serait très intéressant, s’ils ont été filmés, qu’on puisse voir comment ils se sont passés. Au moment où l’éducation artistique a du plomb dans l’aile, l’expérience de démarche artistique conduite ici – et qui a, quand même, mené des jeunes à la Palme d’Or à Cannes – mérite d’être regardée de près… Toujours du côté de l’œuvre d’art, il faut, évidemment, souligner la finesse de l’analyse du personnage principal, François Marin : fragile et sûr de lui à la fois, affectant un certain détachement et, pourtant, surinvesti dans son métier, cultivant une posture généreuse, mais incapable d’en dérouler les conséquences, cherchant à maîtriser les situations, mais sans pouvoir les structurer, acculé à un face-à-face qui devient vite un corps à corps. Le portrait est juste et émouvant. C’est une trajectoire singulière qui nous est donnée à voir avec beaucoup de talent et de sensibilité. Une trajectoire qui se solde par un échec, artificiellement camouflé, in extremis, par un happy end convenu et peu crédible, à la manière du théâtre classique. A priori, il n’y a donc pas de quoi s’inquiéter : la singularité de cette histoire la préserve de toute récupération. Impossible de statuer sur la question de l’école et de la pédagogie, sur celle de l’autorité ou celle de la violence à partir d’une histoire parmi d’autres, d’un portrait très spécifique et incarné. Impossible, a fortiori, de conclure au fiasco de l’École tout entière sur la base d’un ratage individuel, aussi bien décrit soit-il. Nul ne songe à ramener la question de l’amour au XVIIIème siècle à la seule analyse de Manon Lescaut, fort heureusement !
Mais, les choses se compliquent pour toute une série de raisons. D’abord, nous sommes, dans les deux sens du terme, en « terrain sensible ». Directement ou fantasmatiquement, chacun se sent concerné par une situation qui renvoie à des éléments constitutifs de notre fantasmatique collective : la peur que nos enfants ne soient victimes des « barbares » qui ont déferlé sur l’école, l’inquiétude devant les soubresauts d’une jeunesse qu’on craint de ne plus être capable de maîtriser, l’affaiblissement d’une société incapable d’affirmer ses principes et de crédibiliser ses valeurs. Mais, plus encore peut-être, ce qui brouille les cartes, c’est le « réalisme » du film. Il est indiscutable ! Nul ne peut nier que la plupart des dialogues et des situations sonnent terriblement juste. Même si les portraits sont caricaturaux, le tableau est assez suggestif pour qu’on reconnaisse, plus ou moins, « les conditions de l’enseignement aujourd’hui dans un collège difficile ». Pourtant – il faut le rappeler – procéder ainsi, c’est ignorer que la vérité d’une œuvre d’art n’est pas produite par la justesse des décors et le caractère vraisemblable des répliques, mais par la densité de ce qui se noue dans « l’intrigue », de ce qui est en jeu dans la configuration dramatique. Or, la configuration dramatique du film n’est pas du tout celle du roman. Dans le film, contrairement au roman, les choses se trament et se nouent autour du personnage de Souleymane. Un jour, celui-ci tutoie l’enseignant avec agressivité et blesse involontairement une de ses camarades en sortant violemment de la classe : tout est parti, semble-t-il, d’un débat épineux sur le fait de savoir si le professeur avait ou non le droit de traiter de « pétasses » les deux déléguées en raison de leur comportement en conseil de classe. Souleymane est exclu à l’issue d’un conseil de discipline assez surréaliste où il sert lui-même d’interprète à sa mère (alors que, dans le livre, la mère en est absente). L’épisode est clos : le film laisse entendre qu’une fois Souleymane parti, tout rentre plus ou moins dans l’ordre jusqu’à la grande réconciliation festive de fin d’année. Or, si l’on regarde les choses de près, le véritable déclencheur de « l’incident » – déclencheur qui n’existe pas dans le livre – est, à mes yeux, la découverte par Souleymane du fait que son professeur de français a dit, en conseil de classe, qu’il était « limité ». Un bref mouvement de caméra nous montre, d’ailleurs, la rupture sur le visage de l’élève : alors qu’une relation affective s’était établie avec le professeur, tout bascule pour lui. Il se vit, tout d’un coup, comme trahi et son départ de la classe n’est que la concrétisation d’une expulsion symbolique qui a déjà eu lieu. Expulsion qui sera logiquement entérinée par le conseil de discipline… Ainsi, par sa construction dramatique, par souci de faire du cliché et de surfer sur la joute oratoire autour des « pétasses », le film escamote ce qu’il montre : que l’École est niée dès qu’on tente de fonder la confiance sur la seule relation affective, sans « contrat intellectuel », sans engagement réciproque sur des enjeux cognitifs qui permettent de s’exhausser au-dessus du seul présent pulsionnel. L’École est niée dès qu’on refuse l’éducabilité d’un seul élève.
C’est qu’en réalité, le film n’est jamais véritablement « entre les murs » de l’école. Ici, il n’y a pas véritablement d’ « École », de celle qu’on doit « faire », parce que, justement, elle n’existe pas spontanément. On vit dans quelque chose qui ressemble à une école, où il y a des personnages qu’on trouve habituellement dans les écoles, avec des rituels qui sont ceux des écoles… mais sans véritable « École ». Jamais, on n’est mis en face d’une situation d’apprentissage vraiment construite, avec des contenus exigeants, des consignes claires, des activités précisément encadrées. Ce qu’on nous montre comme matrice pédagogique, c’est un vague cours magistral dialogué – Rien à voir avec Socrate, comme le disent certains ! –, où, en l’absence de structuration pédagogique, de lest intellectuel, d’enjeux culturels, le professeur est contraint de jouer avec la séduction, la pression et la sanction… Ainsi, le travail sur le Journal d’Anne Frank est à peine ébauché – malgré un beau moment de lecture qui pourrait augurer du meilleur – et l’exercice de l’autoportrait s’effectue sans le moindre filet, avec une prise de risque maximale et quasiment aucune chance d’aboutir. En effet, s’il y a quelque chose que la pédagogie nous a apprise, c’est que parler de soi sans tomber dans la banalité ou l’exhibition voyeuriste est extrêmement difficile. Cela suppose des médiations, une vraie distanciation, une progression longue et patiente, le plus souvent du « il » au « je ». Cela suppose aussi un travail sur la complexité de la langue et pas seulement une improvisation à partir d’un questionnaire « J’aime - J’aime pas ». Évidemment, il est parfaitement possible que François Marin ait fait ce travail « hors champ ». Mais le film ne permet pas de le voir. Tout au contraire : si ce travail a été fait, il est aboli, pour le spectateur, par la complaisance avec laquelle sont montrés des rapports humains réduits à un combat de coqs entre le professeur et quelques élèves à la personnalité plus affirmée. Les autres élèves, comme le travail quotidien de construction pédagogique, passent à la trappe et le film ne donne à voir qu’une cocotte-minute affective en situation de surchauffe… Avec l’hypothèse vraisemblable, évidemment, que, devant le danger réel de l’explosion que François Marin lui-même ne parvient pas à éviter, de bonnes âmes, particulièrement influentes, en appellent à un surcroît d’autoritarisme. Quand il faudrait, bien plutôt, un surcroît de pédagogie. Il faut toujours, à cet égard, revenir à ce qui constitue un principe régulateur fondamental de l’activité pédagogique : « N’organisez pas la discipline, organisez le travail. Les problèmes de discipline, c’est ce qui reste quand tout a été fait pour que chacun ait un cadre, une place, un travail et un accompagnement personnalisé. Il faut alors les traiter avec en mémoire la maxime fondamentale du droit républicain : c’est la faute qui exclut et la sanction qui (ré)intégre. Par la sanction, le sujet doit retrouver une place, fonctionnelle et symbolique, dans le collectif… Ce qui ne signifie nullement, bien évidemment, que cette sanction doive être une "partie de plaisir", mais qu’elle vise, en même temps, la reconstruction du collectif et de la personne concernée : la "bonne" sanction – toujours très difficile à trouver – se reconnaît à ce qu’elle obéit à ces deux critères. » Laxisme ou autoritarisme : en est-on encore là ? La question de l’autorité sera donc au cœur du débat que va susciter le film. Car nous savons bien que ce film n’arrive pas dans une sorte d’apesanteur sociale et idéologique. Il arrive dans un contexte saturé d’idéologie. Notre société a laissé se développer de tels phénomènes de dérégulation sociale et de surexcitation pulsionnelle qu’elle prend peur devant sa propre jeunesse. Les partisans de l’éducation – qui osent parler de prévention et expliquer qu’une « pédagogie par le projet » avec de vraies ambitions culturelles n’a jamais encore été tentée sérieusement et sur la durée – sont ringardisés systématiquement par les spécialistes du « y a qu’à » dépister, repérer, orienter, médicaliser, sanctionner, réprimer, contenir… « Tenir » : tout est là ! Il faut les « tenir » ! Certes, il n’est pas question de laisser les enseignants à l’abandon sans aucun soutien de leur institution. Les vrais soutiens – et pas seulement l’arsenal des sanctions dont on dispose contre les élèves – font d’ailleurs, souvent, défaut dans l’Éducation nationale… et sont tragiquement absents dans l’établissement du film ! Il n’est pas question, non plus, de regarder sans réagir les débordements dont les professeurs sont victimes, voire d’organiser le naufrage du soldat Marin en lui ôtant tout moyen institutionnel pour contrôler les situations sociales explosives qu’il doit affronter. Cela serait, sans aucun doute, irresponsable. Mais on peut tenter, quand même, de l’aider à organiser des espaces et des temps dévolus au travail intellectuel, des rituels qui permettent de créer des postures mentales de disponibilité aux savoirs, des dispositifs d’apprentissage où les élèves soient véritablement actifs… au vrai sens du terme : intellectuellement actifs, et pas seulement physiquement et psychiquement agités. Rien de facile pour y parvenir. Il faut travailler sans cesse sur le sursis : « Tu as le droit de parler, de discuter et, même, de critiquer, mais à condition que tu prennes le temps de penser. Attendre. Passer par l’écriture. S’inscrire dans des institutions ». Pas de miracle pour y parvenir. Un travail complexe. Avec des avancées et des retours en arrière. Une obstination nécessaire. Une autorité ferme qui désamorce les impulsions et retarde le passage à l’acte. Un vrai travail pédagogique. À mille lieues de tout laxisme, mais aussi de tout autoritarisme. Loin de l’illusion d’une « égalité » radicale entre les élèves et les maîtres, mais loin aussi de l’échec programmé des procédures de dressage social temporaire qui ne font que préparer des explosions psychiques et sociales inévitables. Un débat à recadrer… François Marin – qui n’est pas François Bégaudeau – déborde de bonnes intentions. Il aime ses élèves… et l’on ne peut pas le lui reprocher ! Il les défend contre toutes les assignations à l’échec (ou presque)… il a raison ! Il cherche à faire des ponts entre la « culture jeune » et les savoirs scolaires… on ne peut avancer autrement ! Il entend des paroles de ses élèves que nul autre n’est capable d’entendre : on peut s’interroger sur les risques professionnels réels qu’il prend là et sur les dérapages inévitables… mais il faut alors interroger aussi la société tout entière sur le déficit de communication éducative en direction des adolescents… Reste que François Marin s’englue dans l’affectif… Comme le dit si joliment et justement un collègue, Jean-Luc Estellon, en référence–clin d’œil à une séquence du film sur la conjugaison : « François Marin, c’est l’imparfait du subjectif » ! Non qu’il faille tenter vainement de suspendre toute affectivité et toute subjectivité dans la gestion d’une classe. Ce serait mission impossible : combien d’affectivité faudrait-il pour suspendre l’affectivité ? Et la neutralité affective est toujours une neutralité affectée… On ne suspend pas les affects par décret : on les régule à travers des médiations, médiations par les contenus, médiations par les dispositifs. Des contenus et des dispositifs qui donnent forme et permettent de sortir du chaos des pulsions qui s’entrechoquent et des coagulations d’élèves indifférenciés. Notre École manque de médiations : les savoirs enseignés n’ont souvent aucune saveur, pour reprendre le titre d’un beau livre récent de Jean-Pierre Astolfi (La saveur des savoirs, ESF, 2008) et les dispositifs proposés sont souvent absurdes ou obsolètes : comment mobiliser des élèves sur le travail intellectuel dans des établissements qui vivent au rythme des sonneries stridentes, d’emplois du temps absurdes, sous le signe de l’anonymat généralisé et de la déresponsabilisation permanente ? La pédagogie est, justement, le travail sur les médiations : sur les œuvres, les savoirs et les institutions… tout ce qui permet de se mettre en jeu « à propos de quelque chose ». La pédagogie institue ce qui, à la fois, relie les êtres entre eux et leur permet de se distinguer. Elle est un travail de longue haleine sur « la table » autour de laquelle les hommes peuvent tenter des relations pacifiées en se coltinant avec des enjeux forts. Ainsi comprise, elle est peu présente dans le film… Il n’est pas question d’en faire le moindre reproche aux auteurs et réalisateur. Mais il faut absolument refuser que ce film soit interprété par les uns comme un acte de foi dans une pédagogie compassionnelle qui se suffirait à elle-même et, par les autres, comme la dénonciation implicite d’une démission éducative orchestrée par quelques pédagogues irresponsables. La pédagogie est un travail inlassable pour organiser le travail intellectuel en structurant le cadre et en proposant des contenus exigeants et mobilisateurs… Elle nécessite une éthique et des savoirs professionnels, une passion pour les contenus qu’on enseigne et la capacité à construire des situations de travail. Visiblement, sous cet angle elle est encore peu connue du « grand public ». Les pédagogues ont encore du travail. |

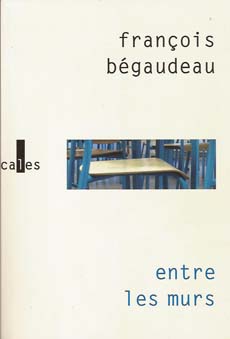 Le littéraire et le pédagogique sont dans un bateau…
Le littéraire et le pédagogique sont dans un bateau… Une transposition dramatique problématique
Une transposition dramatique problématique L’École dramatiquement absente
L’École dramatiquement absente